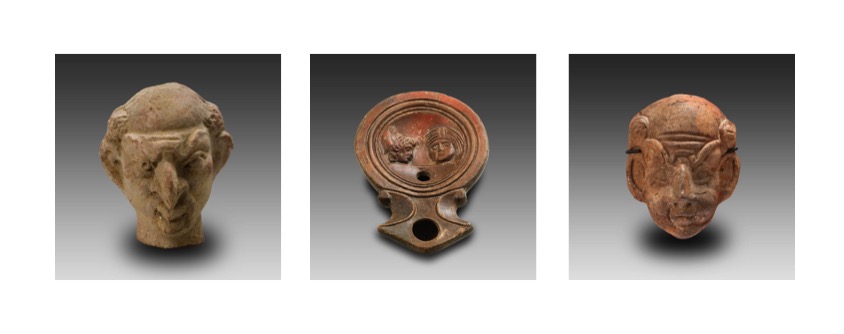
Athènes, VIe siècle avant J.-C.; le tyran Pisistrate, qui règne alors en maître sur la cité grecque, institue un concours de tragédies dans le cadre des grandes Dionysies, célébrées annuellement au début du printemps. Les pièces d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide connaissent un succès considérable et attirent un public nombreux dans les amphithéâtres.
Plus de 2’000 ans plus tard, autre société, autres moeurs; pourtant ces textes anciens continuent d’exercer la même fascination qu’alors sur l’esprit de notre temps.
Comment expliquer un tel engouement, pérenne qui plus est?
Le fait que la tragédie grecque soit aux racines de notre culture occidentale n’est sans doute pas étranger à cette fascination, ni le mystère qui entoure encore ses origines et son histoire. Son âge d’or s’achève vers la fin du Ve siècle avant J.-C. déjà, et c’est moins de 10% des oeuvres représentées lors de ces concours tragiques qui sont parvenus jusqu’à nous. Comme l’exprime merveilleusement Jacqueline de Romilly: «Ce fut […] une éclosion soudaine, brève, éblouissante. La tragédie grecque, avec sa moisson de chefs-d’œuvre, dura en tout quatre-vingts ans».
Toutefois, au delà de ces considérations d’ordre archéologiques, force est de constater que les textes de ces pièces n’ont pas pris la poussière en 25 siècles, et que les mots qui les composent ont gardé toute leur force. Il n’est, par conséquent, pas étonnant que les tragédies grecques aient inspiré bon nombre d’auteurs. Très tôt, les dramaturges Romains, puis ceux de la Renaissance ont réinventé les thèmes chers aux tragiques grecs. Ce sont ensuite Shakespeare, Racine et plus près de nous, Anouilh, Cocteau ou encore Bauchau qui ont relayé les destinées des héros mythiques de l’Antiquité, sans omettre les nombreux libretti d’opéra qui reprennent les sujets et les personnages propres aux théâtre classique grec.
La tragédie grecque met en scène des personnages illustres, déchirés par des passions qui les entraînent à agir en contradiction avec leur conscience morale. Malgré une ambivalence sous-jacente, le fait que ces héros soient accablés par le destin suscite pitié et terreur chez le spectateur. Le pathétique est provoqué par le décalage entre les espoirs du héros, qui tente d’échapper à son destin, et la conscience qu’a le spectateur de la vanité de ces efforts. Selon les mots de Jacqueline de Romilly, «l’épopée racontait: la tragédie montra. […] Dans la tragédie, en effet, tout est là, sous les yeux, réel, proche, immédiat. On y croit. On a peur».
Dans les pièces d’Eschyle, les héros sont des instruments entre les mains des dieux; ils luttent en vain contre la fatalité, dans des tirades pleines de grandeur toutefois. Chez Sophocle et Euripide, en revanche, les hommes ont davantage de responsabilité dans la conduite des événements et dans les malheurs qu’ils provoquent. Les trois auteurs ont cependant ceci en commun que leur oeuvre littéraire pose la question de l’homme face au destin et à son désir de liberté. C’est la raison pour laquelle ces tragédies restent d’une actualité étonnante, puisqu’elles permettent de s’interroger sur le rapport de l’homme au monde, au delà de toute frontière temporelle et géographique. Les écrits d’Eschyle, Sophocle et Euripide démontrent combien l’âme humaine est restée la même à travers les siècles et nous rappellent que les passions existent depuis qu’il y a des hommes.
Au final, on s’aperçoit que la relecture de ces pièces tragiques ouvre sur un monde empreint de modernité, simplement parce qu’il révèle un univers tragiquement humain.
Martine Bouilloux

